
Dialectes des nomades au Maroc
Publié le 30 Déc 2024
Qu'est-ce qui rend un mot unique ? Est-ce l'histoire qu'il raconte ou la façon dont il sonne ? Mettez-vous à l'aise au milieu du Sahara. Le vent semble porter des histoires et le sable murmure sous vos pieds. Ces histoires sont-elles audibles ? Il s'agit d'histoires, de voyages, de coutumes et d'un mode de vie influencé par l'immensité de la terre. Mais quelle est la sonorité de ces récits ? Chaque lieu a une voix unique, et chaque voix a des secrets. Les nomades du Maroc parlent une langue unique. Leurs dialectes, transmis de génération en génération, reflètent leur mode de vie simple, mais profonde. Conformément à l'adage « les mots sont aussi des voyageurs, ils vont où nous allons », les peuples nomades ont préservé leurs différents dialectes au fil du temps, en particulier au Maroc.
Vous découvrirez quelque chose de remarquable au fur et à mesure que vous vous aventurerez dans les dunes des déserts du Maroc. Les nomades communiquent entre eux, partagent leurs connaissances et affrontent les difficultés du désert avec leurs mots. Mais comment ces dialectes perdurent-ils dans un monde en constante évolution ? Que peut-on apprendre sur les locuteurs de ces dialectes ? Comment capturent-ils l'essence de ceux qui n'ont pas de maison ?
Écoutons les nomades du Maroc et découvrons la beauté de leur langue. Êtes-vous prêts à entendre ?
Vous découvrirez quelque chose de remarquable au fur et à mesure que vous vous aventurerez dans les dunes des déserts du Maroc. Les nomades communiquent entre eux, partagent leurs connaissances et affrontent les difficultés du désert avec leurs mots. Mais comment ces dialectes perdurent-ils dans un monde en constante évolution ? Que peut-on apprendre sur les locuteurs de ces dialectes ? Comment capturent-ils l'essence de ceux qui n'ont pas de maison ?
Écoutons les nomades du Maroc et découvrons la beauté de leur langue. Êtes-vous prêts à entendre ?
Mais avant tout qui sont les nomades du Maroc ? Un peu d'histoire…
Au moment de la conquête de l'Algérie, les populations autochtones d'Afrique du Nord étaient connues sous le nom d'Arabes. Cependant, on s'est rapidement aperçu qu'un nombre d'entre eux - connus sous le nom de Berbères ou, plus communément, de Kabyles - parlait une langue autre que l'arabe. Le contraste frappant entre les Kabyles et les Arabes, censés être différents non seulement en termes d'apparence et de mode de vie, mais aussi de coutumes et de mœurs, est devenu un thème populaire de la littérature coloniale. Mais on a fini par reconnaître que cette opposition n'était guère justifiée étant donné l'extraordinaire brassage de la majorité des tribus du Maghreb au cours des âges. (Augustin & Moussard, 1924)
À savoir que la région du Maghreb se trouve entre la mer Méditerranée, le Sahel, l'océan Atlantique et l'Égypte. Cela constitue la partie occidentale du monde arabe et l'aire culturelle arabo-berbère. (Taine-Cheikh, 2017) En d'autres termes, les habitants du Sahara, le plus grand désert chaud, sont les nomades du Maghreb. On les appelle aussi Touaregs. Néanmoins, les habitants du désert du Soudan, du Niger et du Mali sont désignés par ce nom. À l'origine, les Touaregs (Mali) étaient appelés les hommes libres, les voilées ou les Tamasheq. Le terme « hommes bleus » fait référence aux vêtements indigo des nomades Touaregs et sahariens. On estime à 4 millions le nombre de Touaregs et de nomades vivant dans le Sahara.
C'est aux abords du désert que résident ces nomades. Plus précisément, la région sud du Maroc abrite les nomades sahraouis. Pour cet article, les dialectes des nomades du Maroc concerne directement les différents dialectes des tribus berbères.
À savoir que la région du Maghreb se trouve entre la mer Méditerranée, le Sahel, l'océan Atlantique et l'Égypte. Cela constitue la partie occidentale du monde arabe et l'aire culturelle arabo-berbère. (Taine-Cheikh, 2017) En d'autres termes, les habitants du Sahara, le plus grand désert chaud, sont les nomades du Maghreb. On les appelle aussi Touaregs. Néanmoins, les habitants du désert du Soudan, du Niger et du Mali sont désignés par ce nom. À l'origine, les Touaregs (Mali) étaient appelés les hommes libres, les voilées ou les Tamasheq. Le terme « hommes bleus » fait référence aux vêtements indigo des nomades Touaregs et sahariens. On estime à 4 millions le nombre de Touaregs et de nomades vivant dans le Sahara.
C'est aux abords du désert que résident ces nomades. Plus précisément, la région sud du Maroc abrite les nomades sahraouis. Pour cet article, les dialectes des nomades du Maroc concerne directement les différents dialectes des tribus berbères.

Classification des dialectes des nomades du Maroc
Les langues officielles du Maroc
Bien que de nombreuses langues régionales et étrangères soient également parlées au Maroc, l'arabe, en particulier l'arabe dialectal marocain, est la langue la plus couramment parlée au Maroc. Le berbère marocain standard et l'arabe moderne standard sont les langues officielles du Maroc. Alors que les langues berbères sont utilisées comme langues vernaculaires par de larges segments de la population, l'arabe marocain, également appelé darija, est de loin la langue vernaculaire et la lingua franca la plus parlée. L'arabe dans ses formes classique et moderne standard, ainsi qu'occasionnellement le français, qui est une deuxième langue pour environ 33% des Marocains, sont les langues de prestige au Maroc. (Gonthier, 2007)
Dans de nombreuses régions rurales du Maroc, le berbère est utilisé comme langue vernaculaire. Deux langues sont parlées dans les maisons et dans les rues : le berbère et l'arabe marocain. Le berbère n'est pas utilisé par la population pour écrire. Selon Aleya Rouchdy, éditrice de Language Contact and Language Conflict in Arabic, les principaux contextes dans lesquels le berbère est utilisé sont la « rue », l'amitié et la famille. (Rouchdy, 2002)
Dans de nombreuses régions rurales du Maroc, le berbère est utilisé comme langue vernaculaire. Deux langues sont parlées dans les maisons et dans les rues : le berbère et l'arabe marocain. Le berbère n'est pas utilisé par la population pour écrire. Selon Aleya Rouchdy, éditrice de Language Contact and Language Conflict in Arabic, les principaux contextes dans lesquels le berbère est utilisé sont la « rue », l'amitié et la famille. (Rouchdy, 2002)
Le Berbère : les dialectes des nomades du Maroc
Il est extrêmement difficile de délimiter les dialectes d'un même groupe linguistique. Les Berbères du Maroc se répartissent cependant en quatre groupes selon l'idiome dont ils parlent : les Zénètes, les Rifains, les Berabers et les Chleuhs, si l'on considère les principales divisions géographiques et périodes historiques. Ainsi, Zenatia, Tarifit, Tamazirt et Tachelhit sont les quatre groupes de dialectes des nomades du Maroc.
Zenatia et Tarifit constituent le groupe nord, tandis que Tamazirt et Tachelhit constituent le groupe sud. Ces quatre groupes sont eux-mêmes semblables les uns aux autres. Après une période de contact relativement brève, ils semblent tous se comprendre sans effort. Cependant, les Berbères du premier groupe ne comprennent pas ceux du second groupe. En plus, les nomades sahraouis parlent le hassanya ou le hassanya dans le Sud marocain.
Découvrons ainsi, dans ce qui suit, les 5 dialectes les plus utilisés par les nomades du Maroc.
Zenatia et Tarifit constituent le groupe nord, tandis que Tamazirt et Tachelhit constituent le groupe sud. Ces quatre groupes sont eux-mêmes semblables les uns aux autres. Après une période de contact relativement brève, ils semblent tous se comprendre sans effort. Cependant, les Berbères du premier groupe ne comprennent pas ceux du second groupe. En plus, les nomades sahraouis parlent le hassanya ou le hassanya dans le Sud marocain.
Découvrons ainsi, dans ce qui suit, les 5 dialectes les plus utilisés par les nomades du Maroc.
Les dialectes des nomades du Maroc : le Zenatia
Les Zénètes, une des grandes branches de la famille berbère, paraissent être les derniers arrivés dans la région méditerranéenne. Les dialectes des nomades de ce groupe du Maroc sont répandus dans toute l'Afrique du Nord et dans les oasis. Au Maroc, les envahisseurs zénètes semblent venus de l'Algérie centrale seulement aux X-XII siècles. La zenatia occupe, au nord de la plaine d'Oudjda, le massif des Beni Snassen. Sur la rive gauche de la Moulouya, les Kebdana, les Mtalsa, et les Beni bou Yahi appartiennent au même groupe et se relient aux Rifains par des transitions insensibles.
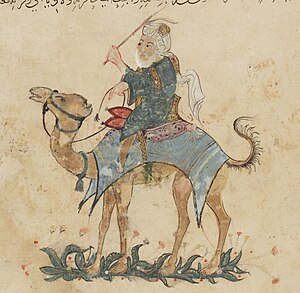
Caractéristiques du Zenatia
Kossmann affirme que les innovations suivantes sont typiques des langues zenats :
- Préfixe nominal avec voyelle omise : Dans les préfixes nominaux, la voyelle « a- » est omise devant une consonne simple et une voyelle pleine (par exemple, afus « main » devient fus). Certaines langues berbères orientales, mais pas le nafusi, subissent des changements similaires.
- La fusion aoriste/parfait élimine la distinction entre les verbes, dont l'aoriste, se termine par -u et le parfait par -a. Par exemple, en Ouargli, ktu, « oublier » devient tta.
- Les verbes, dont l'aoriste ne comporte que des voyelles schwa, se combinent en un seul parfait avec une voyelle finale variable, à l'exception du parfait négatif de əɣ s « vouloir » (par exemple, gər « jeter » en kabyle devient gru en ouargli). C'est ce qu'on appelle le parfait vocalique uniforme des verbes.
- Le proto-berbère -əβ se transforme en -i : Par exemple, arəβ « écrire » devient ari. Le proto-berbère -əβ devient -i. Le tamazight, le nafusi et le siwi dans l'Atlas central connaissent également ce phénomène.
- En proto-Berbère, k' et g' étaient palatalisés pour devenir š et Ͼ (par exemple, k'ăm « tu (f. sg.) » devient šəm). Bien qu'il y ait des exceptions sporadiques, cela se produit également dans le Nafusi et le Siwi.
Les dialectes des nomades du Maroc : les Rifains
Les linguistes affirment que les Rifains parlent un vocabulaire chleuh et une grammaire zénète. Leurs tribus sont connues pour leurs contributions et leurs réalisations historiques. Ils sont dispersés à l'ouest des rivières Garet et Oued Kert, le long de la côte méditerranéenne. Ce groupe inclut les Targuist, les Zerket, les Beni Seddat, les Beni Saïd, les Beni Oulichek, les Beni Touzin, les Beni Ouriaghel et les Mtioua.
Même si les montagnes offrent une protection quasi impénétrable, le dialecte Tarifit semble en grand danger. Les Beni Touzin, Marnissa et Gueznaïa sont partiellement arabisés dans le sud. Seuls trois Ghomara parlent encore l'ancienne langue, que leurs voisins, les Beni bou Nser, ont déjà abandonnée au profit de l'arabe. Les autres Ghomara parlent un arabe pauvre qui rappelle le tamazirt. Les Berbères de l'ouest semblent également reculer. Pour les Beni bou Frah, dans les environs de Mestassa, les circonstances et les dangers sont les mêmes.
Même si les montagnes offrent une protection quasi impénétrable, le dialecte Tarifit semble en grand danger. Les Beni Touzin, Marnissa et Gueznaïa sont partiellement arabisés dans le sud. Seuls trois Ghomara parlent encore l'ancienne langue, que leurs voisins, les Beni bou Nser, ont déjà abandonnée au profit de l'arabe. Les autres Ghomara parlent un arabe pauvre qui rappelle le tamazirt. Les Berbères de l'ouest semblent également reculer. Pour les Beni bou Frah, dans les environs de Mestassa, les circonstances et les dangers sont les mêmes.
Les dialectes des nomades du Maroc : les Berberes
Les Berbères forment un troisième ensemble, à contours moins nets que les précédents, mais d'une importance numérique plus grande. Ils se rattachent à la souche des Sanhadja et leur dialecte s'appelle le tamazirt. On peut les subdiviser en trois groupes. Un premier groupe comprend les Alt Youssi, qui, limités au Nord par les tribus de langue arabe de la région de Fès, Oulad el Hadj, Cherarda, Hayaïna, occupent toute la région qui s'étend jusqu'à la haute Moulouya, à l'Ouest et au Sud des Beni Quarain.
En 2003, Tamazight a été mis en œuvre pour la première fois dans 317 écoles ; en 2012, il s'était étendu à environ 4 000 écoles et 14 000 enseignants.
L'alphabet tifinagh, qui n'est pas d'usage courant, n'est utilisé pour enseigner la langue qu'au niveau primaire. Le tamazight n'est pratiquement pas enseigné dans les écoles privées du pays. L'introduction de l'enseignement de la langue amazighe dans les écoles privées a été discutée lors d'une réunion entre le ministre de l'éducation et les représentants des écoles publiques le 15 mai 2024.
En 2003, Tamazight a été mis en œuvre pour la première fois dans 317 écoles ; en 2012, il s'était étendu à environ 4 000 écoles et 14 000 enseignants.
L'alphabet tifinagh, qui n'est pas d'usage courant, n'est utilisé pour enseigner la langue qu'au niveau primaire. Le tamazight n'est pratiquement pas enseigné dans les écoles privées du pays. L'introduction de l'enseignement de la langue amazighe dans les écoles privées a été discutée lors d'une réunion entre le ministre de l'éducation et les représentants des écoles publiques le 15 mai 2024.
Les dialectes des nomades du Maroc : les Chleuhs
Les Chleuhs, qui habitent l'Anti-Atlas et la partie occidentale du Haut Atlas, sont à peu près aussi nombreux que les Beraber et semblent descendre principalement du groupe Masmouda. Demnat est entouré par les Aït Ayad, les Alt Attab, les Ntifa', les Aït Messat, les Alt bou Zid et les Oultana sur l'Oued el Abid et l'Oued Tessaout. Les Mesfioua, Touggana, Ouzguita et Sektana se trouvent plus loin dans la plaine, encerclant Marrakech et formant une frontière septentrionale avec les Zemrane et les Oudaïa. Le pays berbère s'étend à l'ouest des Fys jusqu'à la mer, en passant par la dépression de Taroudant et la zone indéterminée de Ksima au sud et en contrôlant le pays Chiadma au nord.
Les voyelles
Les trois voyelles principales du Chleuh sont /a/, /i/ et /u/. Il n'y a pas de variation de longueur entre elles. Les sons environnants influencent leur prononciation :
- Le son /a/ est généralement [a] ou [ae], mais il peut se transformer en [ɐ] lorsqu'il se rapproche de consonnes pharyngées. Kraḍ [krɐdˤ] (« trois ») en est un exemple.
- Près de certaines consonnes, les sons /i/ et /u/ peuvent se transformer en [ɪ] ou [ʊ].
- Des mots empruntés comme rristora (« restaurant ») contiennent des voyelles supplémentaires comme /o/.
Les consonnes
Les consonnes simples et pharyngées (« emphatiques ») font partie du système consonantique varié du Chleuh. Les caractéristiques importantes incluent :
- Les sons tels que /kʷ/, /qʷ/ et /gʷ/ sont labialisés.
- Les différences entre tamda « étang » et tamdda « buse » sont des exemples de gémination contrastive.
- Les sons français empruntés, comme /p/ (par exemple, laplaj, « plage »).
- Selon la situation, certaines consonnes, comme w et j, alternent entre les rôles de semi-voyelles ([w], [j]) et de voyelles ([u], [i]).
Les syllabes
Les syllabes chleuhs sont caractéristiques et souvent voyelles. Les consonnes seules peuvent constituer une syllabe, comme dans tkkst stt (« tu l'as emporté ») [tk.ks.tst].
Parmi les modèles de syllabes, on trouve :
- CV, CVC, CV : sont des voyelles.
- CC, CCC, et C:CC sont des consonnes.
Les dialectes des nomades du Maroc : Hassanya
Les Arabes mauritaniens et maliens, ainsi que les Sahraouis, parlent l'arabe hassanya (arabe : حسانية, romanisé : Ḥassānīya) ; il est également appelé Hassaniyya, Klem El Bithan, Hassani, Hassaniya et Maure. Les tribus bédouines Beni Ḥassān, originaires du Yémen et qui ont régné sur la majeure partie de la Mauritanie et du Sahara occidental du XVe au XVIIe siècle, le parlaient. La région pré-moderne autour de Chinguetti était habitée par des locuteurs de l'arabe Hassaniya. Les langues berbères qui étaient parlées à l'origine dans cette région ont été totalement supplantées par cette langue. Bien qu'il s'agisse d'un dialecte nettement occidental, la Hassānīya est assez différente des autres dialectes arabes parlés dans la région du Maghreb. En raison de sa situation géographique, le zenaga-berbère et le pulaar ont pu l'influencer. La principale différence entre les différents dialectes du Hassaniya est leur phonétique. L'arabe hassanya, parlé entre Rio de Oro et Tombouctou, contient encore des vestiges de l'arabe du Sud.
Les caractéristiques du Hassani
Le dialecte hassani présente des caractéristiques phonétiques et morphologiques particulières parmi les dialectes des nomades du Maroc. Il présente un degré élevé d'unité malgré l'étendue de la zone géographique sur laquelle il est parlé, et lorsqu'il y a des différences, elles sont essentiellement lexicales.
Comme d'autres dialectes des nomades du Maroc, le Hassaniya présente des variations phonétiques régionales. La principale variation est la prononciation de la lettre « Kaf » comme « Ghine ». Cependant, comme une grande partie de son vocabulaire est dérivé de l'arabe classique, Hassaniya a réussi à préserver une structure très proche de celle de l'arabe, contrairement aux autres dialectes bédouins d'Afrique du Nord.
En outre, la spécificité du dialecte hassani est démontrée par le fait qu'il emprunte encore de nombreux traits phonétiques et sémantiques à l'arabe ancien. Cela ne l'a pas empêché de s'enrichir au fil du temps de mots et d'expressions d'origine amazighe, notamment dans les domaines de la géographie, de l'agriculture et des herbes médicinales. Étant donné que le dialecte hassani était à l'origine parlé dans les régions amazighes, il fallait s'y attendre. Les locuteurs actuels du hassanya sont en fait un mélange d'arabe et d'Amazighs.
Comme d'autres dialectes des nomades du Maroc, le Hassaniya présente des variations phonétiques régionales. La principale variation est la prononciation de la lettre « Kaf » comme « Ghine ». Cependant, comme une grande partie de son vocabulaire est dérivé de l'arabe classique, Hassaniya a réussi à préserver une structure très proche de celle de l'arabe, contrairement aux autres dialectes bédouins d'Afrique du Nord.
En outre, la spécificité du dialecte hassani est démontrée par le fait qu'il emprunte encore de nombreux traits phonétiques et sémantiques à l'arabe ancien. Cela ne l'a pas empêché de s'enrichir au fil du temps de mots et d'expressions d'origine amazighe, notamment dans les domaines de la géographie, de l'agriculture et des herbes médicinales. Étant donné que le dialecte hassani était à l'origine parlé dans les régions amazighes, il fallait s'y attendre. Les locuteurs actuels du hassanya sont en fait un mélange d'arabe et d'Amazighs.
Conclusion : Les dialectes des nomades du Maroc
Une chose devient évidente au fur et à mesure que nous voyageons à travers les divers paysages du Maroc : la langue est plus que de simples mots. Elle sert de lien avec l'identité, la culture et l'histoire. Chaque dialecte a une histoire unique à raconter, n'est-ce pas fascinant ? Ces dialectes, qui vont de la vivante Hassaniya à la mélodieuse Zenatia, préservent le savoir de nombreuses générations. Ils font preuve d'adaptabilité et de résilience, façonnés par les difficultés de la vie dans les montagnes et le désert. Ces mots ne semblent-ils pas murmurer à travers le temps, comme des échos du passé ?
Cependant, ces langues sont confrontées à de nouvelles difficultés dans un monde qui évolue rapidement. Comment peuvent-elles vivre ? Les peuples ont la réponse. Les nomades vivent leurs dialectes, ils ne se contentent pas de les parler. Ils perdurent et s'adaptent, comme l'eau qui cisèle la pierre. Les nomades marocains sont la preuve que « chaque langue est une maison ». Même en l'absence d'une résidence permanente, leurs mots leur servent de fondement. N'est-il pas admirable qu'ils conservent leurs coutumes ?
Écoutons donc ce qu'ils ont à dire. Honorons leurs langues. Elles nous rappellent que la diversité est une force plutôt qu'une faiblesse. « Celui qui apprend une nouvelle langue gagne une nouvelle âme », après tout.
Cependant, ces langues sont confrontées à de nouvelles difficultés dans un monde qui évolue rapidement. Comment peuvent-elles vivre ? Les peuples ont la réponse. Les nomades vivent leurs dialectes, ils ne se contentent pas de les parler. Ils perdurent et s'adaptent, comme l'eau qui cisèle la pierre. Les nomades marocains sont la preuve que « chaque langue est une maison ». Même en l'absence d'une résidence permanente, leurs mots leur servent de fondement. N'est-il pas admirable qu'ils conservent leurs coutumes ?
Écoutons donc ce qu'ils ont à dire. Honorons leurs langues. Elles nous rappellent que la diversité est une force plutôt qu'une faiblesse. « Celui qui apprend une nouvelle langue gagne une nouvelle âme », après tout.
Bibliographie
- Augustin, B., & Moussard, P. (1924). Arabophones et berbérophones au Maroc. Dans Annales de Géographie (pp. 267-282). Armand Colin.
- Gonthier, J. (2007). La francophonie dans le monde. Organisation Internationale de la Francophonie: Nathan.
- Rouchdy, A. (2002). Language Contact and Language Conflict in Arabic: Variations on a Sociolinguistic Theme. Psychology Press, 73.
- Taine-Cheikh, C. (2017). La classification des parlers bédouins du Maghreb : revisiter le classement traditionnel. Prensas de la Universidad de Zaragoza, 15-42.